En Tunisie, plus de la moitié des migrant·es originaires d’Afrique subsaharienne ont déjà subi un acte raciste. | jurien huggins via Unsplash
Qu’elle soit issue d’une émigration récente ou installée depuis des générations en Tunisie, la population noire subit toutes sortes de violences.
De l’importance du vocabulaire. En Tunisie, certains mots utilisés pour désigner les Noir·es révèlent l’étendue du travail qui reste à faire pour changer les mentalités. «Oussif», esclave, «kahlouch», équivalent de noirauds, de nègres, ne choquent pas forcément et font même partie du langage populaire. Beaucoup considèrent tout simplement que ces expressions ne sont pas racistes.
Il y a quinze ans, Blamassi Touré quitte sa Côte d’Ivoire natale pour venir étudier en Tunisie. Dans son pays d’adoption, il se met rapidement à militer. Aujourd’hui, il dirige l’Alda (Association pour le leadership et le développement en Afrique). L’organisation porte bien son nom avec à sa tête ce directeur très charismatique. Blamassi Touré déclame son argumentaire comme une plaidoirie:
«Je ne sais pas comment on peut prouver que quelqu’un a été victime de racisme dans ce contexte de déni où est plongée la Tunisie.[…] On va te dire “écoutez, les gens qui ont les yeux bleus on les appelle ‘zarga’ [bleu, ndlr], les albinos on les appelle ‘rouges’, donc dire ‘kahlouch’ ce n’est pas forcément mauvais, il ne faut pas y associer une connotation péjorative”.»
Ce discours perdure alors que la Tunisie s’est dotée en 2018 d’une loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Une grande première dans la région et pour le pays qui ne disposait jusqu’ici d’aucun cadre juridique sur la question. Ce texte est venu couronner des années de lutte de la société civile.
Désormais sont criminalisés «les propos racistes», mais aussi «l’incitation à la haine», «les menaces racistes», «la diffusion» et «l’apologie du racisme» ainsi que «la création» ou «la participation à une organisation soutenant de façon claire et répétitive les discriminations», des délits passibles de un à trois ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3.000 dinars (1.000 euros).
Premières condamnations
Qu’est-ce qui a changé pour les Noir·es depuis? Blamassi Touré laisse échapper un rire. «Intéressante question. Juste le fait qu’on a une loi et qu’on n’en avait pas avant. C’est tout. Parce qu’avoir une loi est une chose, mettre en place le cadre de son application en est une autre.»
Un sondage réalisé en 2019 par une association de défense des droits humains, le FTDES (Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux), montre que plus de la moitié des migrant·es originaires d’Afrique subsaharienne ont déjà subi un acte raciste.
«Les gens sont étonnés de le voir descendre d’une voiture de luxe, de le voir porter un costume. Ils ne peuvent pas imaginer que les Noirs puissent avoir un statut social aussi élevé.»
Sherifa Riahi, directrice de l’association Terre d’asile Tunisie
Blamassi Touré décrit le rejet qui s’exprime au quotidien: «Est-ce que le racisme est toujours là? Oui. Est-ce qu’aujourd’hui si un Noir se balade avec une Tunisienne il est susceptible de se faire tabasser? Oui. Est-ce que quand tu te présentes aujourd’hui pour louer une maison, on te regarde droit dans les yeux et on te dit “non je ne loue pas aux Africains”? La réponse est oui.»
Deux affaires ont abouti à des jugements selon Saadia Mosbah, présidente de l’association anti-raciste Mnemty. Il y a eu de nombreuses plaintes mais les procédures traînent, déplore la militante. La seule chose positive qu’elle retient, «c’est que les gens ne sont plus contraints au silence, il y a moins de honte».
Stéréotypes
L’association Terre d’asile Tunisie défend les droits des migrant·es. À chaque fois qu’elle reçoit une personne pour la première fois, elle lui fait remplir une fiche «d’identification des besoins» où figure «un récit de vie» avec notamment le détail de son parcours migratoire. «On détecte alors les différentes violences, les discriminations subies», explique Sherifa Riahi, la directrice de l’organisation.
De ses nombreux entretiens, elle tire une typologie des préjugés dont sont victimes les Noir·es en Tunisie. «On a eu le témoignage d’un diplomate qui vit ici depuis plusieurs années. Il raconte que les gens sont étonnés de le voir descendre d’une voiture de luxe, de le voir porter un costume. Ils ne peuvent pas imaginer que les Noirs puissent avoir un statut social aussi élevé.»
Mais il n’y a pas que ce cliché du déclassement social. La société tunisienne a à sa disposition un réservoir de stéréotypes dans lequel tout le monde puise, des couches les plus populaires aux élites. Les Noirs ceci, les Noires cela… ainsi, les Noires auraient une sexualité débridée. «Les femmes sont très souvent victimes d’agression, de harcèlement, déplore Sherifa Riahi. On pense que ce sont des filles faciles.» Quand elles ne sont pas tout simplement discriminées au travail.
«Les Noirs auraient des aptitudes physiques supérieures à celles des Blancs. Donc on leur confie des travaux plus difficiles.» Sur cette question des stéréotypes et bien d’autres encore, un livre est à consulter en particulier: Noirs au Maghreb – Enjeux identitaires, ouvrage réalisé sous la direction de l’anthropologue Stéphanie Pouessel.
Pour Blamassi Touré, la grande majorité des Tunisien·nes est consciente de l’existence du racisme, peut imaginer en être victime à l’étranger, mais impossible pour elle de reconnaître qu’il s’exprime au sein même de sa société. «En tant que musulman, le Tunisien se dit qu’il ne peut pas être raciste puisque l’islam l’interdit.» Le message universaliste d’égalité prêché dans les mosquées tunisiennes cache mal le paradoxe d’une société nord-africaine centrée sur son identité arabo-musulmane.
Aux origines
Ce sont ces tiraillements que pointe du doigt l’historien Salah Trabelsi. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, il revient aux sources de la discrimination qui frappe les Noir·es au Maghreb et expose le refoulé d’une région qui revendique sa prétendue «arabité» et rejette «avec force [son] africanité».
Le chercheur fait remonter «cette négation de soi» à l’islamisation de l’Afrique du Nord qui s’est faite, dit-il, «non sans mépris envers les Berbères». Les élites locales vont tout faire dès lors pour se dissocier de ce peuple considéré comme «vil, fruste et sauvage».
«Donner vingt-six coups de couteau à un être humain c’est de l’acharnement, et qu’est-ce qui a motivé cet acharnement?»
Blamassi Touré, directeur de l’Association pour le leadership et le développement en Afrique
Enfin, rappelle l’historien, «la noirceur de peau a toujours constitué, selon la plupart des exégètes musulmans, un défaut inacceptable et ce au même titre que tous les autres vices rédhibitoires pour accéder au pouvoir suprême». S’ajoute à cela la longue histoire de l’esclavage dans les pays arabes et «l’émergence tardive de la question des inégalités sociales et raciales».
Tunisien·nes ou étrangèr·es, les Noir·es sont toujours considéré·es comme étant à part, «repérables à des caractéristiques ethniques et socioculturelles présumées distinctes», estime Salah Trabelsi.
Des violences multiples
Retour en 2020, dans la Tunisie d’aujourd’hui. La voix des associations antiracistes porte davantage désormais. Dans les médias au moins, où elles dénoncent régulièrement les agressions dont sont victimes les Noir·es. Des militant·es écouté·es mais pas forcément entendu·es. Le caractère raciste des violences fait systématiquement débat, comme en décembre 2018, lorsque le président de l’Association des Ivoiriens en Tunisie, Falikou Koulibaly, est tué lors d’un vol qui tourne mal.
«Il a reçu vingt-six coups de couteau, se souvient Blamassi Touré. On m’a dit à l’époque que “c’était une agression courante”. Donner vingt-six coups de couteau à un être humain c’est de l’acharnement, et qu’est-ce qui a motivé cet acharnement? Il y a une dimension raciste dans cette affaire. Mais on nous a présenté comme des personnes qui voulaient exagérer…»
Les Noirs subissent toutes les formes de violences. Morales, physiques, économiques, administratives.
Émilienne les a presque toutes vécues. Elle s’est fait tabasser il y a quelques jours. Elle est en Tunisie depuis presque trois ans. Elle a quitté son pays, la Côte d’Ivoire, à cause de la situation sociopolitique. À 47 ans, elle s’est habituée au racisme ambiant. «Qu’est-ce qu’on peut y faire.» Voilà comment elle conclut toutes ses phrases, évoquant tour à tour la violence gratuite dans la rue, les attouchements perpétrés par des enfants qui lui proposent du «sexe» et les brimades de ses collègues au restaurant où elle a travaillé.
À la nuit tombée, elle ne sort plus de chez elle. «La maison-le travail, le travail-la maison. Dimanche à l’église, de l’église à la maison. Terminé. C’est comme ça. J’évite qu’on me tabasse», dit-elle dans un sourire déstabilisant. Le 23 décembre, elle a quitté son ancien boulot, «trop pénible». «Les Tunisiens sont mieux payés que nous et c’est nous qui faisons les tâches difficiles. Parce qu’ils sont chez eux, c’est le raisonnement qu’ils tiennent.»
Noire et en situation irrégulière, elle cumule tous les handicaps. Impossible, pense-t-elle, d’obtenir gain de cause. Elle ne fait pas confiance à la justice et le risque de représailles serait trop grand.
«Nous n’avons pas constaté de volonté politique lors des dernières élections, personne n’a parlé du racisme.»
Saadia Mosbah, présidente de l’association anti-raciste Mnemty
Ce combat contre le racisme anti-noir, Blamassi Touré le mène bien volontiers, mais il ne voudrait pas qu’il se limite aux migrant·es originaires d’Afrique subsaharienne. Bien sûr, ce sont les plus vulnérables, mais selon lui «le Noir tunisien a plus de chances de résoudre le problème». Cela implique une profonde et difficile remise en question de la société tunisienne, portée par une large mobilisation.
Le sujet des discriminations surgit dans les années 2000 au Maghreb avec la publication de plusieurs articles de presse, les militant·es anti-racistes s’en emparent après la révolution tunisienne et quand, en 2018, la loi est enfin votée, leurs rangs se sont déjà clairsemés, le mouvement s’est essoufflé.
Saadia Mosbah note l’apparition de signaux inquiétants: «Nous n’avons pas constaté de volonté politique lors des dernières élections, personne n’a parlé du racisme. On retournerait même à la case départ en disant que c’est un faux problème. […] Il y a comme un retour au déni.»
Une histoire occultée
Qui connaît aujourd’hui ce fait, pourtant saillant? La Tunisie fut l’un des premiers pays de la région à abolir l’esclavage, dès 1846. Une partie des Noir·es du pays est issue de ces populations affranchies il y a 170 ans, mais dont on ne raconte jamais l’histoire. Les Noir·es sont particulièrement nombreuses et nombreux dans le sud, où l’esclavage dura le plus longtemps et où son influence reste la plus visible, notamment au travers de son lexique stigmatisant toujours employé aujourd’hui.
Il entretient la confusion entre couleur de peau et asservissement. Les Noir·es sont parfois appelé·es «abid», mot arabe qui veut dire esclaves. En miroir, les Blanc·hes sont désigné·es par le terme «ahrar»: «hommes libres». L’humiliation ne s’arrête pas là. Dans certaines mairies de Djerba est encore mentionné sur les extraits de naissance des descendant·es d’esclaves le mot «atig» qui signifie «affranchi par». Djerba, où est encore appliquée de manière traditionnelle une ségrégation raciale, jusque dans la mort. Sur l’île subsiste «le cimetière des esclaves», lieu d’inhumation réservé aux Noir·es tunisien·nes.
Gosba, dans la région de Médenine, est surnommé le «village des Noirs». Les habitant·es dénoncent leur condition de citoyen·nes de seconde zone. Dans un rapport du groupe de réflexion EuroMeSCo, on apprend que la condition sociale des Noir·es tunisien·nes n’est absolument pas homogène comme on pourrait s’y attendre. Mais «la majorité habite dans des régions marginalisées et sous-développées et appartient aux couches les plus pauvres».
Pour comprendre la situation du sud tunisien, il faut aussi avoir à l’esprit qu’«être noir n’est pas qu’une question de couleur». La généalogie supposée, les liens familiaux entretenus avec des populations asservies ont plus d’importance. Dans la réalité, Noir·es et Blanc·hes n’affichent souvent aucune différence physique.
Il n’y a aucune donnée statistique officielle, mais les Noir·es représenteraient aujourd’hui entre 10 et 15% de la population. Absent·es des médias, des postes à responsabilités, dans l’économie et en politique, largement sous-représenté·es dans le milieu de l’art, les Noir·es tunisien·nes sont presque invisibles.
Source : Slate



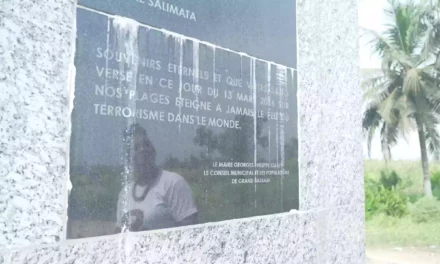











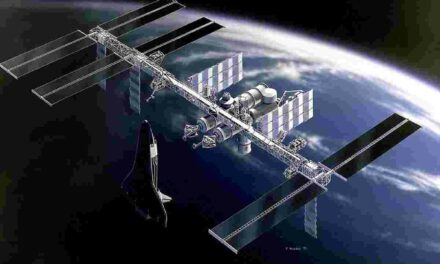


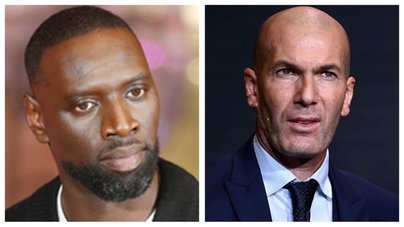










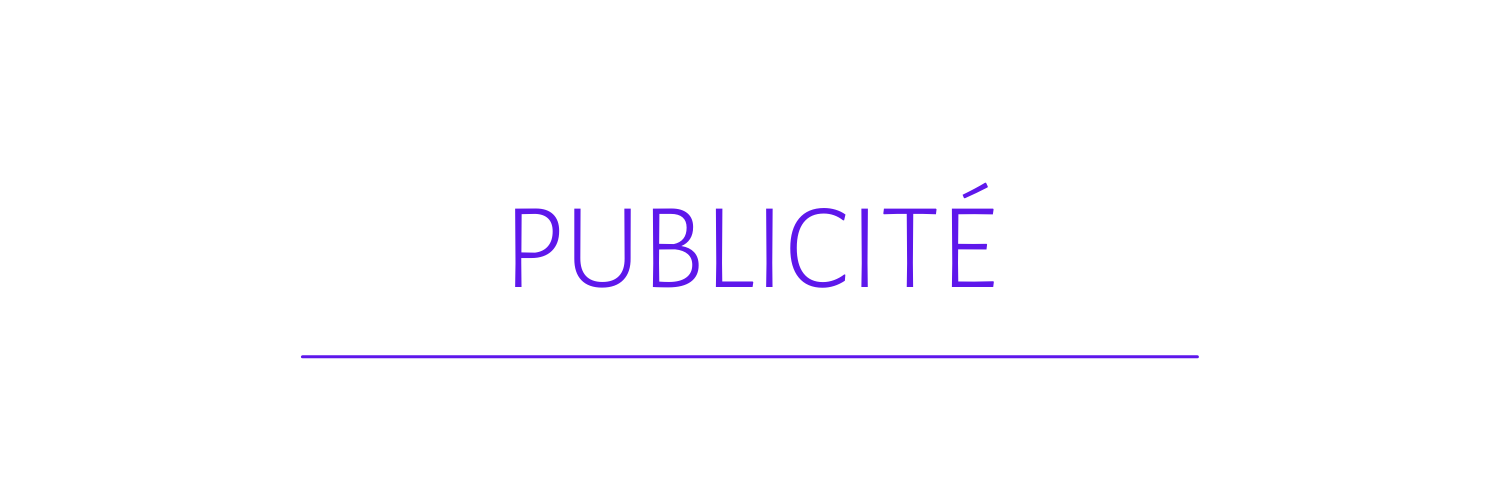

Commentaires récents